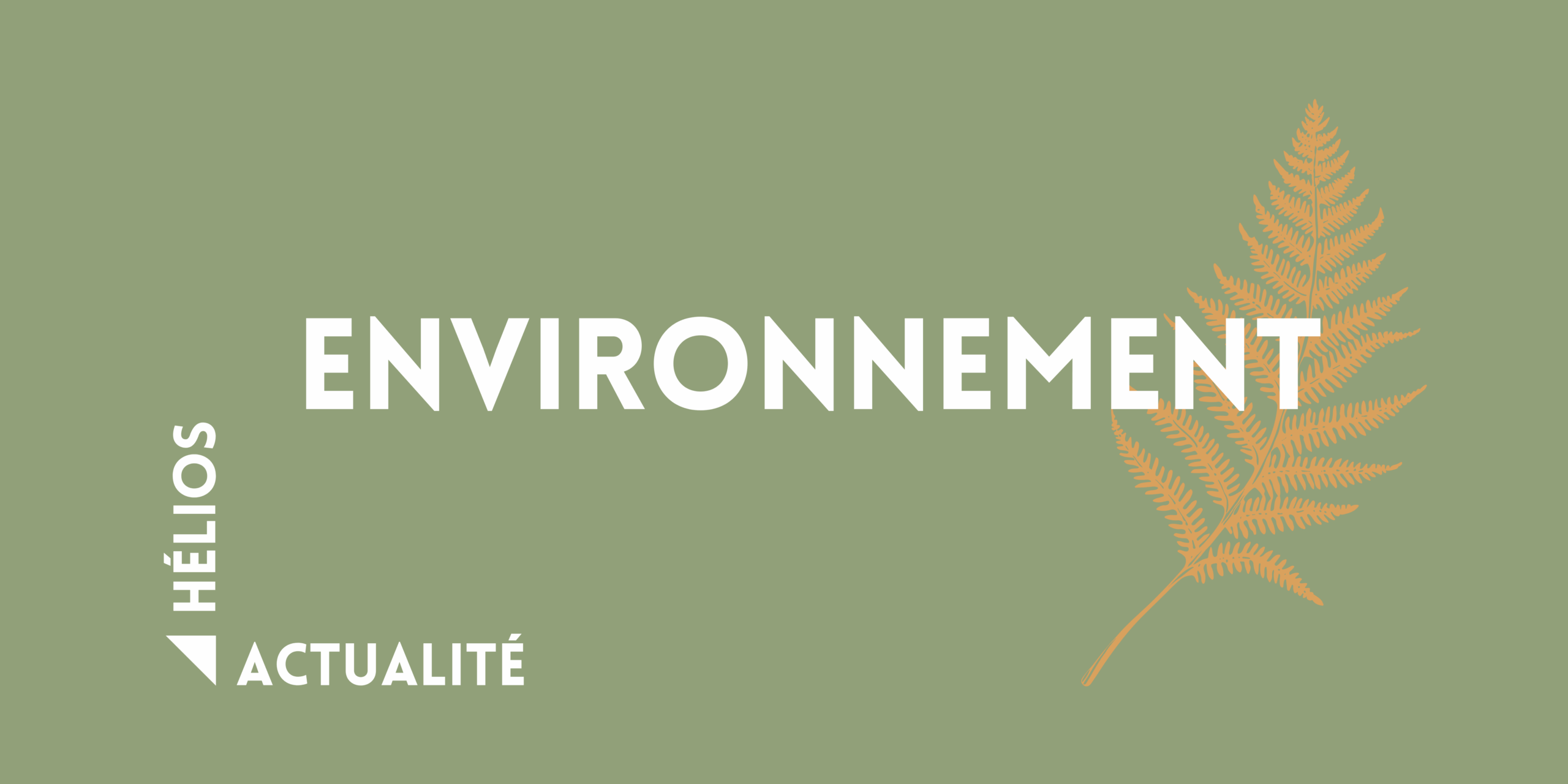Article rédigé par Matteo Polito, stagiaire auditeur de justice
Le 15 mai 2025, le groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires, et en particulier la sénatrice Antoinette GUHL, a déposé une proposition de loi visant à renforcer les obligations de la convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale (CJIPe).
À l’origine : le scandale des eaux en bouteille
Cette proposition de loi intervient en suite de nombreuses péripéties médiatiques, judiciaires et législatives sur ce qui est désormais appelé le « scandale des eaux en bouteille ».
En janvier 2024, le journal Le Monde et la cellule investigation de Radio France révèlent les pratiques trompeuses à grande échelle des producteurs d’eau en bouteille sur le territoire et notamment le cas de la société Nestlé Waters qui, à Vittel, aurait eu recours à des techniques de purification pourtant interdites sur les eaux de source ainsi qu’à des forages non autorisés.
La justice s’est ainsi emparée du sujet et une CJIPe a été signée entre le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Epinal et la société Nestlé Waters Supply Est, filiale du groupe agroalimentaire multinational Nestlé.
Dans le cadre de cette CJIPe, la société Nestlé Waters Supply Est a accepté :
- de verser une amende d’intérêt public d’un montant de deux millions d’euros,
- de réparer l’impact écologique provoqué grâce à des travaux de restauration pour un montant total d’un million d’euros,
- d’indemniser plusieurs associations de protection de l’environnement du territoire ainsi que des associations de défense des consommateurs au titre de la réparation de leur préjudice moral.
Le Sénat s’est également saisi de ce sujet. Antoinette GUHL a notamment rendu un rapport « flash » d’information sur les « politiques publiques en matière de contrôle des traitements des eaux minérales naturelles et de source », déposé en octobre 2024.
Plus récemment, une commission d’enquête parlementaire sur les « pratiques des industriels de l’eau en bouteille et les responsabilités des pouvoirs publics dans les défaillances du contrôle de leurs activités » a rendu public son rapport tendant à sécuriser la qualité des eaux minérales et de source.
Dans ce rapport, les sénateurs pointent « l’impression d’un manque de transparence et d’une atténuation de la sanction » par la CJIPe et proposent, notamment, l’établissement de lignes directrices sur la mise en œuvre de la CJIPe par la Chancellerie.
C’est dans ce contexte qu’est déposée la proposition de loi visant à renforcer les obligations de la CJIPe.
La proposition de loi déposée le 15 mai 2025
Dans l’exposé des motifs, les sénateurs insistent sur le manque de transparence au stade de la négociation entre le Parquet et la personne morale mise en cause mais aussi sur la prétendue faiblesse de la réponse pénale, le montant des amendes négociées n’ayant jamais atteint les 30% du chiffre d’affaires annuel moyen calculé sur les trois dernières années.
Les auteurs de la proposition de loi souhaitent ainsi réformer la procédure pour « plus de transparence et de rigueur ».
Pour cela, le texte suggère de modifier l’article 41-1-3 du code de procédure pénale relatif à la CJIPe pour restreindre son champ (1) ouvrir la procédure à de nouveaux acteurs (2) et alourdir la sanction négociée (3).
1️⃣ La restriction du champ de la CJIPe
L’article 41-1-3 du code de procédure pénal tel que rédigé actuellement permet au procureur de la République de recourir à la CJIPe lorsqu’un délit prévu par le code de l’environnement a été commis par une personne morale.
Dans un souci de cohérence de l’action publique, les infractions connexes, c’est-à-dire reliées au délit environnemental par un lien suffisant, peuvent être intégrées à la CJIPe, hors crimes et délits graves contre les personnes.
Le texte prévoit d’exclure les infractions connexes du champ de la CJIPe. Cela aurait pour effet de limiter les CJIPe aux seules atteintes à l’environnement et, dans le même temps, de permettre au ministère public de poursuivre toutes les autres infractions, notamment commerciales.
On peut y voir un écueil. Comment convaincre une personne morale de s’engager dans une CJIPe, de produire des pièces dans le cadre de la négociation et in fine, même officieusement, de reconnaître une forme de culpabilité, si celle-ci risque des poursuites pénales dans le même dossier mais avec des chefs d’infraction différents ?
La CJIPe pourrait être instrumentalisée comme un aveu de culpabilité et, ainsi, devenir obsolète aux yeux des sociétés qui n’y verraient plus un intérêt.
2️⃣ L’ouverture de la CJIPe à de nouveaux acteurs
Le texte sénatorial propose d’ouvrir la phase de négociation entre le Parquet et la personne morale mise en cause à d’autres acteurs au nom de la transparence.
Le procureur de la République devrait notamment informer puis solliciter les collectivités territoriales et les associations de protections de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement constituées parties civiles, tout comme les fédérations départementales de pêche.
Il s’agit ici d’aligner la procédure sur celle de la CJIP en matière financière qui prévoit cette sollicitation afin que les victimes puissent transmettre au procureur de la République tous les éléments permettant de prouver son préjudice.
L’information de la victime est légitime et la transmission de documents par celle-ci est nécessaire dans la mesure où le montant et les modalités de la réparation seront prévus par la convention.
Toutefois, l’intégration de nouveaux acteurs fait courir le risque d’un raidissement et d’un allongement de la procédure qui, justement, fonctionne grâce à sa souplesse et au nombre limité d’acteurs autour de la table des négociations.
Dans un second temps, le texte propose de renforcer l’opérationnalité de la convention puisque le procureur de la République devrait désigner, dans le cadre de celle-ci, le service compétent en charge du suivi du programme de conformité et de réparation du préjudice écologique négocié. Le service compétent devra établir un rapport annuel de suivi, transmis au Parquet et aux victimes.
Cette disposition permettra sûrement de renforcer l’effectivité des CJIPe, bien que celle-ci ne soit pas particulièrement remise en cause.
3️⃣ L’alourdissement de la sanction négociée
Enfin, la proposition de loi, et c’est la disposition la plus commentée, prévoit l’établissement d’un seuil minimum pour le calcul de l’amende d’intérêt public de 10% du chiffre d’affaires annuel moyen calculé sur les trois dernières années.
Ainsi, cette amende négociée serait enfermée dans une fourchette comprise entre 10% et 30%.
Cette disposition, comparable aux peines planchers, semble opportune dans un premier temps. En effet, elle répond aux critiques sur la faiblesse des amendes négociées par rapport à la peine encourue devant le tribunal correctionnel.
Toutefois, il faut d’abord rappeler que les peines encourues sont rarement prononcées dans leur totalité.
Cette disposition aurait également pour conséquence d’amoindrir la marge de négociation du procureur de la République. Par conséquent, elle pourrait empêcher la prise en compte ajustée de la situation d’une personne morale mise en cause.
De plus, cette disposition empêcherait indubitablement la conclusion de certaines CJIPe car le risque contentieux serait moins important pour les personnes mises en cause.
En somme, cette proposition de loi semble se concentrer sur la dimension répressive de la CJIPe. En cela, elle oublie que le mis en cause est toujours libre de refuser de la signer. Le caractère « attractif » du montant de l’amende est donc essentiel.
Mais surtout elle passe sous silence l’un des aspects essentiels du dispositif, qui est la réparation du préjudice écologique. Or, celui-ci se répare par priorité en nature. Il eut mieux valu proposer des dispositions plus précises sur les modalités de réparation d’une part, et prévoir des modalités d’effectivité de cette réparation qui peut s’échelonner sur plusieurs années – pour un coût total bien supérieur à celui de l’amende. Et c’est bien là l’essentiel : réparer ce qui a été altéré.
🔎 Mots clés : CJIP, justice négociée, droit pénal de l’environnement